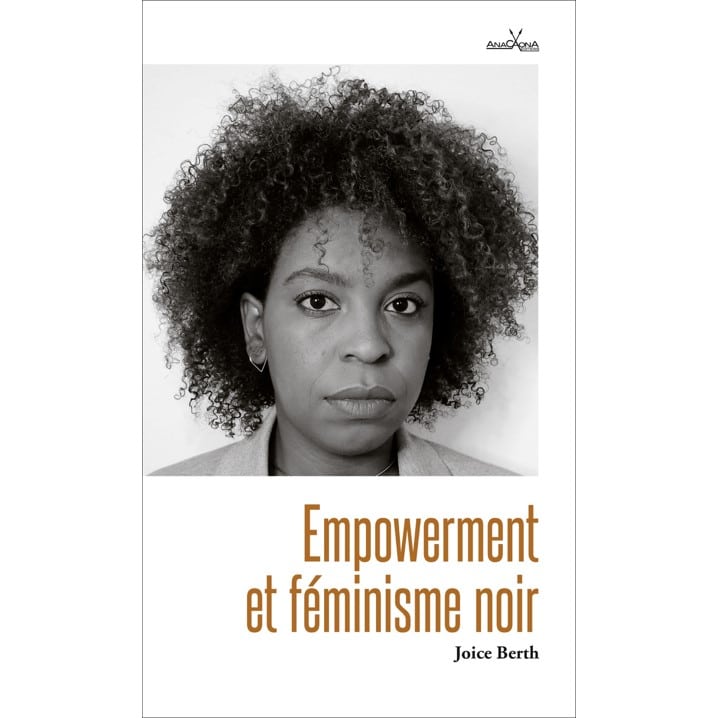Le 20 novembre, nous organisions, avec l’association Autres Brésils, une soirée mémorable autour du féminisme et de la décolonialité. Avec quatre femmes impressionnantes autour de la table, deux françaises et deux brésiliennes : Françoise Vergès et Gerty Dambury, Djamila Ribeiro et Joice Berth.
Toute la soirée est disponible ci-dessous sur Youtube :
Ce sont plus de deux heures de débat passionnant… Retrouvez ici les questions préparées par Gerty Dambury, qui officiait comme modératrice.
Dans son ouvrage Empowerment et féminisme noir, Joice Berth nous propose un historique du mot empowerment, depuis le XVIe siècle, aussi surprenant que cela puisse nous apparaître, jusqu’à nos jours, en passant par les travaux de Paulo Freire et bien d’autres encore. Joice Berth nous permet également d’approcher la manière dont le terme empowerment a été central dans la réflexion de féministes noires, de bell hooks à Patricia Hill Collins, d’Angela Davis à Madalena Léon ou à Grada Kilomba et bien d’autres. Elle revient sur les nombreuses définitions qui ont été accolées au mot, à son utilisation dans les politiques du « développement », à l’accent mis sur l’aspect purement individuel de l’empowerment quand, pour sa part, elle plaide pour une « symbiose du processus individuel avec le collectif. »
Djamila Ribeiro, pour sa part, présente signe deux ouvrages traduits en français par Paula Anacaona : La place de la parole noire et Chroniques sur le féminisme noir. Dans le premier ouvrage, elle décrypte la façon dont la parole est autorisée, entendue ou valorisée en fonction de la place d’où parle celui ou celle qui s’exprime. Trois questions posées par Grada Kilomba pourraient, en quelque sorte, résumer pour nous cette approche de la « place de la parole » que nous propose Djamila Ribeiro : « Qui peut parler ? » « Que se passe-t-il quand nous parlons ? » et « Sur quoi nous est-il permis de parler ? « Son analyse de la réaction du groupe dominant, qui a toujours eu le pouvoir, à la prise de parole des groupes dominés est tout à fait intéressante et fait écho à un certain nombre de réactions violentes que nous pouvons voir, ici en France, depuis que les groupes dominés, profitant de la surface de visibilité que leur offrent les réseaux sociaux, font entendre leur voix. Le deuxième ouvrage est composé d’une série de textes courts publiés à l’origine dans la presse. Elle y aborde des sujets très divers ayant toujours trait au racisme et à la place des femmes : l’humour comme arme, l’émotion sélective (où l’on s’aperçoit que la perte de vies noires produit moins d’émotion dans le public et la presse), la manière dont on parle du corps de Serena Williams, le blackface ou encore Métissage et culture du viol.
Enfin, l’ouvrage Un féminisme décolonial de Françoise Vergès est constitué de deux parties qui s’intitulent : « Définir un camp, le féminisme décolonial » et « L’évolution vers un féminisme civilisationel du XXIè siècle ». L’étude de ce qui constitue le féminisme décolonial montre en creux les limites du féminisme blanc (ou universel) : le féminisme décolonial s’inscrit dans une longue filiation de luttes contre les colonisations, l’esclavage des Noir.e.s, le capitalisme mais également aujourd’hui contre un féminisme qui s’intègre parfaitement à l’ordre néolibéral et réduit les aspirations révolutionnaires à une demande de partage des privilèges des hommes blancs et qui se refuse à analyser le rôle des femmes dans l’esclavage et la possibilité pour elles de posséder des êtres humains. (Aussi longtemps que l’histoire des droits des femmes sera écrite sans tenir compte de ce privilège, elle sera mensongère »).Dans la deuxième partie de son ouvrage, Françoise Vergès analyse plus spécifiquement la manière dont de grands figures du féminisme blanc lancent et participent à une guerre ouverte contre les femmes racisées, en particulier les femmes musulmanes, s’inscrivant comme partenaires et complices d’un pouvoir néo-libéral.

Question introductive pour les 3 autrices : Vous êtes trois femmes racisées qui placent leur travail d’analyse et de recherche, ainsi que leurs activités militantes, dans la continuité des luttes menées avant nous par les femmes des groupes dominés. Joice Berth parle de « résistances » des femmes esclaves comme d’un empowerment intuitif », Djamila Ribeiro, place en introduction de son ouvrage La place de la parole noire, le discours de Sojourner Truth et l’analyse comme un texte de l’intersectionalité avant la lettre et Françoise Vergès fait également référence à un « féminisme du marronnage » en résistance à la traite et à l’esclavage.
Question aux trois invitées : De quelle manière l’analyse de cet héritage a-t-il permis une autre approche de la condition de « femme » comme le suggère Angela Davis dans son ouvrage Femmes, race et classe ?
Question à Joice Berth. Lecture d’un extrait de Empowerment et féminisme noir :
« C’est un fait, le féminisme noir ou le mouvement des femmes noire au sein des féminismes a permis le sauvetage conceptuel et la ressignification de l’empowerment. Étant à la base de la pyramide sociale, ce sauvetage s’avère fondamental pour agir contre la formation hégémonique de cette pyramide. Nous employons sciemment le mot « sauvetage » car les mouvements de femmes noires ont toujours eu besoin de chercher des processus d’empowerment pour survivre et ce n’est pas nouveau. Même si les théories de l’empowerment ont été conceptualisées par des hommes blancs, ce sont les pratiques intersectionnelles des femmes noires qui ont placé de façon irréversible ce concept dans le groupe des actions et des stratégies de lutte de tous les mouvements pour l’émancipation et la libération sociopolitique »
Question : Vous évoquez à plusieurs reprises le fait que la notion d’empowerment puisse être vue comme un facteur de développement individuel, vous évoquez également le risque que, même en prenant l’empowerment dans va version d’autonomisation collective, elle puisse ne pas nous conduire à une remise en question, en profondeur, des facteurs structurels qui perpétuent les dominations. À la lueur de toutes ces mises en garde et après plus de 40 ans de bons et loyaux services, quel intérêt présente encore la notion d’empowerment aujourd’hui, et éventuellement, quels nouveaux développements lui prédisez-vous, en l’analysant à partir du féminisme noir ?
Question à Djamila Ribeiro. Lecture d’un extrait de La place de la parole noire :
« Quand nous parlons d’identités, nous disons que le pouvoir en légitime certaines au détriment d’autres. Le débat, cependant, n’est pas uniquement identitaire et exige de réfléchir à la façon dont certaines identités sont avilies et de donner une nouvelle signification au concept d’humanité, vu que les noirs en général, et les femmes noires en particulier, ne sont pas tréités comme des humaines. Puisque le concept d’humanité ne prend en compte que les hommes blancs, notre lutte vise à penser les bases d’un nouveau cadre civilisateur. C’est une vaste lutte, qui prétend amplifier le projet démocratique. Il est indispensable de lire des auteures noires, en respectant leurs productions de connaissance et en se permettant de penser le monde à travers d’autres verres optiques et d’autres géographies de la raison. C’est une invitation à construire un monde dans lequel la différence ne signifie pas l’inégalité. Un monde où existent d’autres possibilités d’existence qui ne soient pas marquées par la violence de la mise sou silence et de la négation. Nous voulons coexister afin de construire de nouvelles bases sociales. Au final, nous cherchons à amplifier le concept d’homme.
Dans La place de la parole vous dites : « Lorsque l’on a pour objectif la diversité des expériences, il est logique que disparaisse une vision universelle. » Pouvez-vous développer cette question pour le public, à partir de tout ce que vous dites sur la feminist standpoint theory.
Question à Françoise Vergès. Lecture d’un extrait :
« Les femmes racisées sont acceptées dans les rangs des féministes civilisationnelles à la condition qu’elles adhèrent à l’interprétation occidentale du droit des femmes. Aux yeux de leur idéologie, les féministes du Sud global restent inassimilables car elles démontrent l’impossibilité de résoudre en termes d’intégration, de parité et de diversité les contradictions produites par l’impérialisme et le capitalisme. Le féminisme contre-révolutionnaire prend alors la forme d’un fémonationaliste, d’un fémo-impérialisme, d’un fémo-fascisme, ou de marketplace feminism (féminisme du marché. Ces féminismes qui n’ont pas toujours les mêmes arguments et représentations trouvent cependant un point de convergence : ils adhèrent à une mission civilisatrice qui divise le monde entre cultures ouvertes à l’égalité des femmes et cultures hostiles à l’égalité des femmes. »

La question que je vais vous soumettre rejoint un peu celle que j’ai posée à Djamila Ribeiro. Votre ouvrage a été assez violemment critiqué par celles que vous appelez les « féministes universalistes » ou « civilisationnelles », comment analysez-vous ce refus têtu de penser le féminisme à partir de la pensée décoloniale ? Autre question : le féminisme, fût-il noir, suffit-il comme grille d’analyse de la structuration de nos sociétés ?